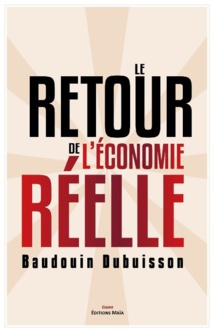Baudouin Dubuisson, vous publiez aux éditions Maïa, « Le retour de l’économie réelle ». Vous parlez de « cercle vicieux » au sujet des interventions des Banques centrales pour alimenter la liquidité des marchés. Qu’entendez-vous par là ?
La politique menée par les banques centrales depuis une vingtaine d’années et surtout depuis la crise de 2008 nous entraîne dans un véritable cercle vicieux. Pour relancer une croissance qui ralentit inexorablement, les banques centrales baissent les taux d’intérêt et injectent de la monnaie dans le circuit économique, mais près de 90 % de celle-ci ne trouvent pas de points de chute dans l’économie réelle ; cette monnaie aboutit systématiquement dans la sphère financière ; elle nourrit la spéculation, la volatilité et l’insécurité. Quelques exemples valent mieux qu’un long discours : sur le seul mois de mars 2020, ce ne sont pas moins de 83 milliards de dollars qui ont fui et mis en danger les pays émergents ; en 2008, en quelques mois l’euro est passé de 1,07 dollar à 1,58 dollar donnant des sueurs froides aux exportateurs. En voulant relancer l’économie, les banques centrales la déstabilisent.
Aujourd’hui que la barre des taux d’intérêt négatifs a été franchie, toute marche arrière est délicate : un relèvement des taux déséquilibrerait beaucoup de pays surendettés et compromettrait les investissements nécessaires pour affronter l’avenir…
Nos indicateurs économiques font-ils encore sens et ne serait-il pas temps de les réformer ?
Les économistes persistent à utiliser un concept vieux de près d’un siècle pour évaluer la santé de l’économie. Dans les années qui ont suivi la grande crise de 1929, l’économiste Simon Kuznets avait imaginé la notion de PIB à la demande du Congrès américain pour évaluer le redressement du pays. À l’époque, 90 % des produits consommés aux États-Unis étaient produits localement.
De nos jours, mondialisation oblige, plus aucun pays ne se trouve dans une telle situation. Les États-Unis ont relancé leur consommation en distribuant des chèques aux consommateurs ; la croissance n’a pas tardé à dépasser les 6 %, du jamais vu depuis des décennies, mais la consommation s’est portée sur des produits importés, ce qui a aggravé le déficit commercial en particulier vis-à-vis de la Chine. En d’autres termes, les deniers publics américains ont eu pour effet d’enrichir leur pire rival ! La consommation n’est donc plus synonyme de création de richesses. La France n’est pas logée à meilleure enseigne : plus de 80 % des produits de consommation courante non alimentaires sont importés et ce sont précisément ces produits qui ont profité du regain de consommation.
Un pays ne s’enrichit vraiment qu’en exportant ce qui n’est possible qu’en disposant d’un potentiel industriel. La bonne santé économique et financière de pays comme la Corée ou l’Allemagne n’est pas le fruit du hasard : dans ces pays l’industrie représente respectivement 40 % et 26 % du PIB alors que les États-Unis n’en sont plus qu’à 18 % et la France à 11 %. Qui plus est, de l’ordre de 80 % des brevets porteurs d’avenir sont le fait de l’industrie…
La crise de la covid a eu ceci de bon qu’elle a mis en évidence les limites d’un indicateur qui mélange consommation et création de richesses. Le PIB n’est qu’un indicateur de niveau d’activité, pas de création de richesses. Il se fait que les recettes fiscales et l’emploi résultent avant tout du taux d’activité, que celle-ci soit commerciale ou industrielle. Toute relance, qu’elle soit basée sur la consommation ou la production, améliore le taux d’activité d’un pays, améliore les recettes fiscales à court terme, mais seules la production et l’exportation enrichissent réellement un pays.
Peut-on vraiment sortir de la logique des machés, au stade où nous en sommes ?
Pendant des décennies l’économie de marché a fait ses preuves en matière de création de richesses, mais la mondialisation a rebattu les cartes. Dans un système qui s’est refermé sur lui-même en intégrant la quasi-totalité des pays de la planète, les règles ont changé. Ralentissement de la croissance mondiale aidant, le jeu économique mondial s’apparente de plus en plus à un jeu à somme nulle : une balance commerciale positive quelque part dans le monde correspond inévitablement à une balance commerciale négative ailleurs sur la planète.
Une entreprise a pour vocation de battre la concurrence voire même de l’éliminer. Avec la mondialisation, ce qui n’était pas possible dans un monde ouvert l’est devenu : on ne compte déjà presque plus les entreprises ou les groupes d’entreprises qui sont parvenus à dominer leur marché. L’avènement du numérique et du « winner takes all » qui l’accompagne ont mis le phénomène en lumière, mais celui-ci ne se limite pas aux GAFA’s. Trois producteurs de minerais fournissent 80 % des besoins mondiaux, deux avionneurs totalisent plus de 90 % des ventes de la planète, trois ou quatre producteurs de batteries pour véhicules électriques se partagent un marché plus que prometteur et les entreprises qui disposent de l’un ou l’autre produit sans concurrence sur une niche de marché sont innombrables. Les 500 plus grandes entreprises représentent plus de la moitié des bénéfices de l’ensemble des entreprises de la planète, mais sont aussi celles qui paient le moins d’impôts ; 70 % du commerce international sont constitués par des échanges intra-entreprises, probablement en bonne partie les 500 plus grandes…nnLa mondialisation a favorisé une hyper-concentration du pouvoir économique.
Dans un tel contexte, le pouvoir politique se doit d’intervenir pour corriger les excès, favoriser la concurrence et une juste répartition de la richesse. Le mouvement a commencé sous l’égide de l’OCDE et du G20 : la taxation équitable des multinationales est un premier pas et les enquêtes actuellement en cours sur les pratiques commerciales visant à empêcher la concurrence de se développer devraient progressivement porter leurs fruits.
Comment envisagez-vous un retour à l’économie réelle ? Avez-vous des propositions concrètes dans ce sens ?
Tout système suit une logique de concentration et de complexification. Revitaliser l’économie de marché passe inexorablement par une simplification des règles, notamment au niveau fiscal, pour que tous les acteurs soient logés à la même enseigne. Par ailleurs il est impératif de recréer une diversité économique en favorisant l’émergence de nouveaux acteurs face à la domination outrancière d’un nombre trop limité de grandes entreprises, surtout au niveau industriel. De nombreuses initiatives peuvent être prises dans cette optique : supprimer l’impôt sur les bénéfices réinvestis (ce qui favorisera avant tout l’industrie), supprimer les droits de succession sur les entreprises familiales pour encourager les entreprises indépendantes, accroître le financement de la recherche en entreprise, mettre sur le même pied la taxation des plus-values en cas de revente et la taxation des bénéfices distribués, limiter le recours à l’endettement en cas d’achat d’entreprise parce que les LBO favorisent trop la concentration du tissu industriel…