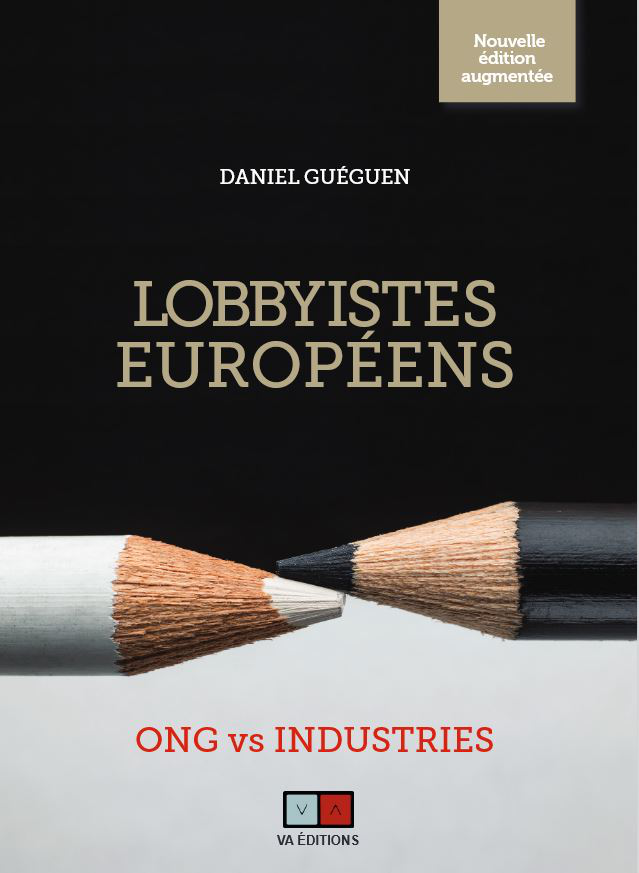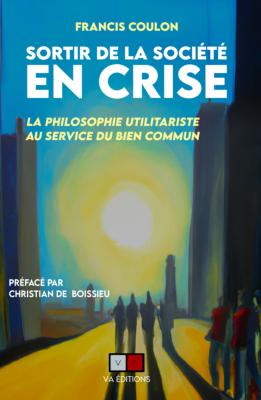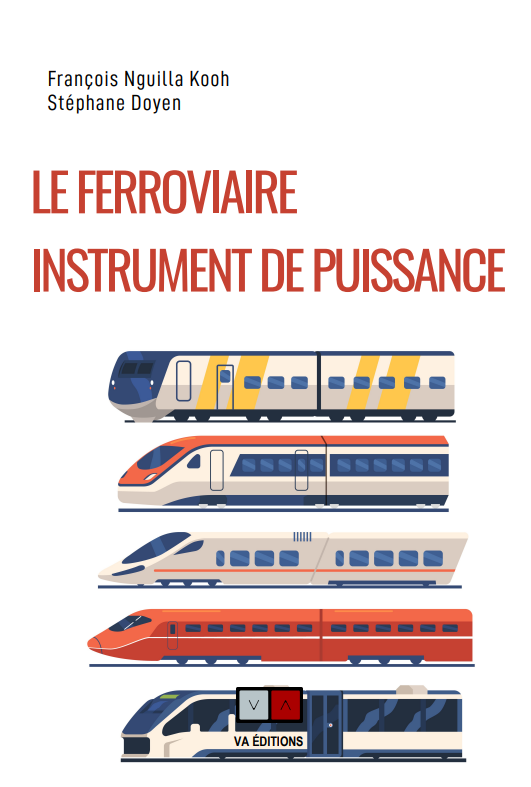Vous venez de publier (pour l’instant, sous forme numérique, en attendant que rouvrent les imprimeries et les librairies) une 3e version totalement révisée de « Fake news » considéré comme un livre de référence. C’est un sujet politique brûlant ?
Presque depuis l’élection de Trump en 2016, ce qui a popularisé l’expression. Dans les deux sens : lui, accuse ses adversaires, à commencer par les grands médias, de ne répandre que des mensonges pour le déstabiliser. Et ses adversaires répètent qu’il a été élu grâce à la diffusion des théories complotistes et de la désinformation en ligne, le tout orchestré par Moscou et quelques extrémistes. Depuis lors, le « bloc élitaire » comme disent les sociologues, fait la guerre, essentiellement sur les réseaux sociaux, contre le faux présenté comme danger idéologique subversif pour nos démocraties. Ceci repose sur trois éléments indéniables : leur prolifération, leur accessibilité croissante, notamment via les communautés en ligne, et surtout la réceptivité du public.
Il suffit de cinq minutes de navigation pour tomber sur une rumeur ou un contenu fantaisiste ; par ailleurs, nous pouvons sans mesurer combien d’informations circulant sur les réseaux sociaux sont réputées « fausses » ou « douteuses » d’après leur nombre de signalements par des individus ou des algorithmes « anti-fake » de Google, Twitter et autres. Sans parler du fait qu’énormément de journaux ou de médias audiovisuels se sont dotés de services de « fact-checking ». La durée de vie d’une information suspecte avant signalisation est très brève, mais elles prolifèrent et les dénoncer ne fait souvent que renforcer la méfiance d’une partie de la population envers le discours « officiel ».
Par ailleurs, il existe des techniques qui portent moins sur l’énonciation/fabrication du faux que sur sa mise en contexte, son accréditation par des sources qui se prétendront neutres, mais aussi des stratégies de « direction de l’attention » comme la création de faux comptes, l’utilisation de robots qui donnent l’impression d’un fort mouvement d’opinion en ligne. Le but peut aussi être d’attirer les moteurs de recherche, de multiplier les « memes » (les unités d’information qui se reproduisent sur les réseaux sociaux par signalisation, liens, reprise, etc.). Bref, c’est la lutte de l’épée et du bouclier à un très haut niveau de technicité.
Prenez n’importe quel thème : les Gilets jaunes, le réchauffement climatique ou les banlieues, vous serez assuré de voir les deux parties s’accuser de fake news.
Le gouvernement vient de créer une plateforme pour lutter contre les infox ou fake news relatives au coronavirus et l’OMS dénonce une « infodémie », la désinformation qui se propage aussi vite que le virus. C’est une nouvelle guerre de l’information ?
Sur fond de scepticisme à l’égard de la science (affaire des vaccins ou du glyphosate p. e.) et de discours médicaux contradictoires, il est question partout de remèdes miraculeux, de morts cachés, de faits imaginaires terrifiants ou scandaleux. Ces bruits se propagent sur les réseaux sociaux où l’on s’imagine recevoir l’information de gens « comme nous », de bonne foi. Plus des théories dites conspirationnistes. Ces dernières fournissent une explication générale et surtout désignent un coupable caché. Suivant le cas Trump, Bill Gates, les militaires chinois cherchant une arme biologique, les capitalismes, etc.
Mais il s’ajoute une dimension géopolitique de guerre de l’information et de désinformation. Milieux dirigeants américains et souvent européens tiennent à peu près le langage suivant :
– Pékin est responsable de l’épidémie et de sa propagation rapide, réalités couvertes par la censure et le mensonge.
– Les Chinois font une énorme propagande, notamment sur le Web 2.0, pour vanter l’efficacité de leur réaction, leur volonté généreuse d’aider le monde et l’excellence de leur modèle idéologique. Ils tentent parallèlement de déstabiliser les systèmes démocratiques.
Ce à quoi la Chine répond que ce sont les Occidentaux qui essaient de cacher leur échec et de pratiquer la subversion à leur égard. Ils plaident la bonne foi, l’efficacité et l’universalité de leurs valeurs.
En elles-mêmes ces réactions semblent prévisibles. Mais avec l’ampleur des opérations d’influence dans ce contexte dramatique, l’enjeu de qui convaincra le monde de son histoire devient énorme. C’est de savoir qui deviendra la puissance hégémonique après la pandémie, et par ses forces matérielles (économiques, techniques, etc.) et par ses forces quasi spirituelles que sont le pouvoir de convaincre et séduire.
Presque depuis l’élection de Trump en 2016, ce qui a popularisé l’expression. Dans les deux sens : lui, accuse ses adversaires, à commencer par les grands médias, de ne répandre que des mensonges pour le déstabiliser. Et ses adversaires répètent qu’il a été élu grâce à la diffusion des théories complotistes et de la désinformation en ligne, le tout orchestré par Moscou et quelques extrémistes. Depuis lors, le « bloc élitaire » comme disent les sociologues, fait la guerre, essentiellement sur les réseaux sociaux, contre le faux présenté comme danger idéologique subversif pour nos démocraties. Ceci repose sur trois éléments indéniables : leur prolifération, leur accessibilité croissante, notamment via les communautés en ligne, et surtout la réceptivité du public.
Il suffit de cinq minutes de navigation pour tomber sur une rumeur ou un contenu fantaisiste ; par ailleurs, nous pouvons sans mesurer combien d’informations circulant sur les réseaux sociaux sont réputées « fausses » ou « douteuses » d’après leur nombre de signalements par des individus ou des algorithmes « anti-fake » de Google, Twitter et autres. Sans parler du fait qu’énormément de journaux ou de médias audiovisuels se sont dotés de services de « fact-checking ». La durée de vie d’une information suspecte avant signalisation est très brève, mais elles prolifèrent et les dénoncer ne fait souvent que renforcer la méfiance d’une partie de la population envers le discours « officiel ».
Par ailleurs, il existe des techniques qui portent moins sur l’énonciation/fabrication du faux que sur sa mise en contexte, son accréditation par des sources qui se prétendront neutres, mais aussi des stratégies de « direction de l’attention » comme la création de faux comptes, l’utilisation de robots qui donnent l’impression d’un fort mouvement d’opinion en ligne. Le but peut aussi être d’attirer les moteurs de recherche, de multiplier les « memes » (les unités d’information qui se reproduisent sur les réseaux sociaux par signalisation, liens, reprise, etc.). Bref, c’est la lutte de l’épée et du bouclier à un très haut niveau de technicité.
Prenez n’importe quel thème : les Gilets jaunes, le réchauffement climatique ou les banlieues, vous serez assuré de voir les deux parties s’accuser de fake news.
Le gouvernement vient de créer une plateforme pour lutter contre les infox ou fake news relatives au coronavirus et l’OMS dénonce une « infodémie », la désinformation qui se propage aussi vite que le virus. C’est une nouvelle guerre de l’information ?
Sur fond de scepticisme à l’égard de la science (affaire des vaccins ou du glyphosate p. e.) et de discours médicaux contradictoires, il est question partout de remèdes miraculeux, de morts cachés, de faits imaginaires terrifiants ou scandaleux. Ces bruits se propagent sur les réseaux sociaux où l’on s’imagine recevoir l’information de gens « comme nous », de bonne foi. Plus des théories dites conspirationnistes. Ces dernières fournissent une explication générale et surtout désignent un coupable caché. Suivant le cas Trump, Bill Gates, les militaires chinois cherchant une arme biologique, les capitalismes, etc.
Mais il s’ajoute une dimension géopolitique de guerre de l’information et de désinformation. Milieux dirigeants américains et souvent européens tiennent à peu près le langage suivant :
– Pékin est responsable de l’épidémie et de sa propagation rapide, réalités couvertes par la censure et le mensonge.
– Les Chinois font une énorme propagande, notamment sur le Web 2.0, pour vanter l’efficacité de leur réaction, leur volonté généreuse d’aider le monde et l’excellence de leur modèle idéologique. Ils tentent parallèlement de déstabiliser les systèmes démocratiques.
Ce à quoi la Chine répond que ce sont les Occidentaux qui essaient de cacher leur échec et de pratiquer la subversion à leur égard. Ils plaident la bonne foi, l’efficacité et l’universalité de leurs valeurs.
En elles-mêmes ces réactions semblent prévisibles. Mais avec l’ampleur des opérations d’influence dans ce contexte dramatique, l’enjeu de qui convaincra le monde de son histoire devient énorme. C’est de savoir qui deviendra la puissance hégémonique après la pandémie, et par ses forces matérielles (économiques, techniques, etc.) et par ses forces quasi spirituelles que sont le pouvoir de convaincre et séduire.
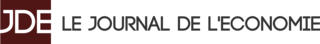































 Inscription Newsletter
Inscription Newsletter