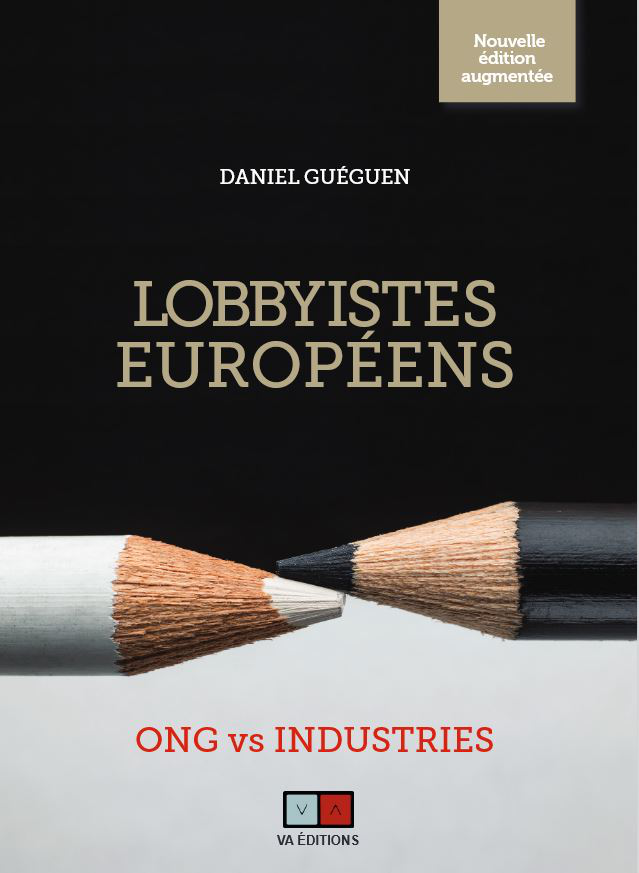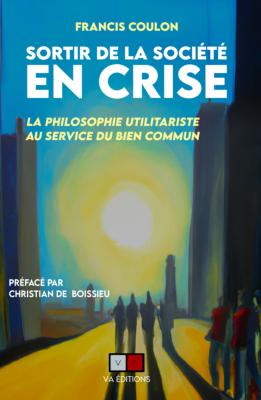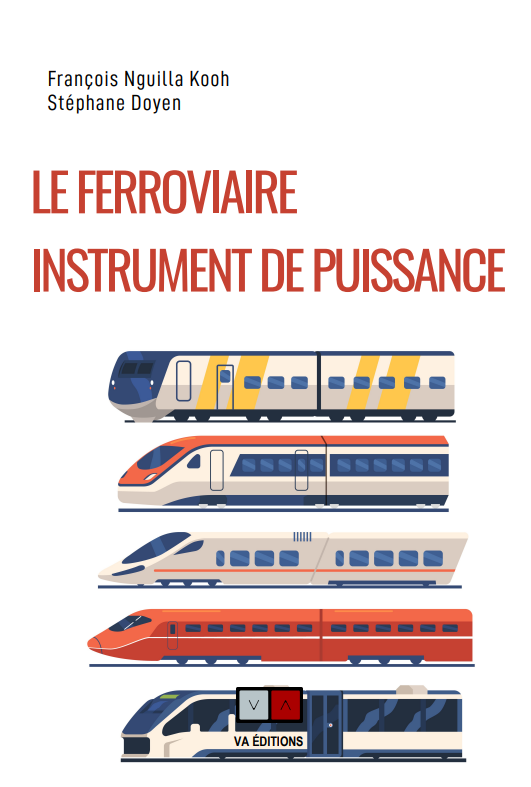Vous êtes un observateur averti de l’évolution du monde politique et économique. Pouvez-vous nous faire part de votre réflexion sur les origines et la signification des phénomènes que nous vivons actuellement ?
Regardons ce début de siècle. Nous arrivons à un carrefour où les menaces se concentrent de façon explosive.
Le fanatisme terroriste, le réveil des guerres religieuses, le réarmement accéléré des Nations, l’apparition des armes « autonomes », la folie nord-coréenne, l’ineptie américaine, l’inertie européenne, les tsunamis migratoires, le ralentissement à moyen terme de la croissance en Occident, la montée irrésistible d’une très grande puissance liberticide, la Chine, la soudaine aggravation de la faim dans le monde, l’explosion démographique, la marée montante de l’endettement, l’irruption de nouvelles technologies disruptives dont personne ne contrôle l’éthique, la poussée de populismes bornés, les tentations séparatistes à courte vue, l’immense licenciement collectif que nous préparent robotisation et digitalisation, l’apparition de mystérieuses crypto monnaies objectivement complices d’une grande criminalité invasive, des agressions informatiques qu’aucune cybersécurité ne sait contenir, des accidents climatiques toujours plus graves, le retour du protectionnisme, se sont rarement conjugués à un tel niveau.
Face à tout cela, les vieilles démocraties, en plein désarroi hésitent entre progressisme béat et déclinisme chagrin. En fait, comme avant-guerre, elles ne se sont pas préparées.
La violence monte. Ce n’est pas la fin du monde. Mais sans doute la fin d’un monde. Il ne s’agit pas ici de vendre l’apocalypse. Ni de dire bêtement qu’hier valait mieux qu’aujourd’hui : sur le long terme les chances du progrès l’emportent toujours sur celles du déclin. Mais il y a sur la route des moments où l’addition des risques atteint un paroxysme. Nous vivons un de ces tournants.
Après les élections, que pensez-vous de la situation en Europe et plus généralement de la montée des populismes dans le monde ?
Partout dans le monde (pas seulement en Europe) on assiste à une inquiétante érosion des valeurs civiques. L’abstention progresse partout alors que la pratique démocratique est d’abord une gouvernance reposant sur le consentement actif des gouvernés. Aujourd’hui un tiers des Européens considèrent que voter « ne sert pas à grand-chose ». Et les trois quarts pensent de toute façon que « la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus ». Les sondages récents sont sans appel, car le discrédit est général : 60 % des citoyens européens ne font pas confiance à leur Parlement. Et c’est au sein des classes populaires que l’opinion sur l’inutilité du vote est la plus répandue. Pour les plus jeunes, entrer en politique aujourd’hui c’est joindre l’inutile au désagréable. D’ailleurs, plus de 40 % d’entre eux en France considèrent que la démocratie n’est pas le seul système politique viable.
De manière évidente, tous les piliers de la démocratie classique sont désormais entrés en crise : le pouvoir politique organisé autour d’une représentation parlementaire ou présidentielle est partout contesté. Cette déstabilisation débouche au mieux sur une exigence de « démocratie participative » et au pire sur la recherche de l’homme fort. Deux tentations dangereuses.
Pourquoi dangereuses ?
Si l’on entend par démocratie participative une mobilisation plus active des citoyens au débat, c’est sympathique et… banal : comment une vraie démocratie ne serait-elle pas participative ? Mais la notion est en plus dangereuse comme on l’a vu en France et en Grande-Bretagne à l’occasion des derniers référendums. Ces appels au peuple sont des faux amis de la démocratie. De plus, dans un système capitaliste mal régulé, il est risqué de demander aux dindes ce qu’elles pensent du dîner de Noël.
Raymond Aron nous mettait en garde avec sagesse lorsqu’il écrivait : « l’homme est un être raisonnable, mais les hommes c’est moins sûr. » Arrêtons de parler des vertus de la démocratie directe. Le peuple est souverain, mais la foule est une bête. Il y a des nuits debout où l’on regrette de ne pas rester couché. Les cuistres qui nous battent les oreilles avec Rome et Athènes oublient de dire que ces démocraties n’en étaient pas : seuls les « citoyens » avaient accès au forum, pas la masse de la plèbe qui faisait pourtant l’essentiel du travail. Diogène n’avait pas le droit de participer au gouvernement de la Cité. Je doute que l’on souhaite revenir à ce mode d’organisation sociale.
En sens inverse, oui un pouvoir fort est parfois source d’efficacité. Mais l’histoire a tranché. Le pouvoir d’un seul c’est une maladie qui se croit un remède. Cette dérive a conduit au pire.
En fait, nous avons été, nous sommes, d’une coupable paresse. La démocratie n’existe pas si les démocrates n’en font pas tous les jours la preuve. Nous avons cru que la démocratie était un acquis immanent alors qu’elle est un combat permanent.
Gardez-vous néanmoins l’espoir d’une révolution enfin positive ? Ou basculer vers le pire est-il une fatalité ?
Je suis hanté par cette question : comment éviter aux générations qui viennent de répéter les erreurs de la nôtre ? Nous avons cru à la République, à l’État, à l’Europe, aux Droits de l’homme, à la laïcité, à la démocratie, au progrès de la technologie… qu’avons-nous fait de tout cela ? J’ai longtemps brocardé le principe de précaution comme le symptôme d’une ridicule aversion au risque. Aujourd’hui, je fais volontiers amende honorable. La vitesse enivre. L’excès de vitesse tue. Alors respectons une pause, prenons un peu de recul et mettons en examen les chauffards du toujours plus. Avant de faire son devoir, il faut être sûr de bien le connaître.
Cette incertitude est-elle nouvelle ? Non, évidemment. Les hommes ont toujours été menacés par les forces du mal et leur destin fut toujours d’avancer en aveugle dans le bruit et la fureur. Mais deux phénomènes se conjuguent désormais : une accélération des évènements et une accumulation des risques. Faut-il le taire pour ne pas diffuser l’inquiétude ? Non, René Girard a écrit : « Vouloir rassurer c’est contribuer au tragique. » Il avait raison : penser le pire ce n’est pas céder à la résignation. C’est même la meilleure façon de l’éviter.
Regardons ce début de siècle. Nous arrivons à un carrefour où les menaces se concentrent de façon explosive.
Le fanatisme terroriste, le réveil des guerres religieuses, le réarmement accéléré des Nations, l’apparition des armes « autonomes », la folie nord-coréenne, l’ineptie américaine, l’inertie européenne, les tsunamis migratoires, le ralentissement à moyen terme de la croissance en Occident, la montée irrésistible d’une très grande puissance liberticide, la Chine, la soudaine aggravation de la faim dans le monde, l’explosion démographique, la marée montante de l’endettement, l’irruption de nouvelles technologies disruptives dont personne ne contrôle l’éthique, la poussée de populismes bornés, les tentations séparatistes à courte vue, l’immense licenciement collectif que nous préparent robotisation et digitalisation, l’apparition de mystérieuses crypto monnaies objectivement complices d’une grande criminalité invasive, des agressions informatiques qu’aucune cybersécurité ne sait contenir, des accidents climatiques toujours plus graves, le retour du protectionnisme, se sont rarement conjugués à un tel niveau.
Face à tout cela, les vieilles démocraties, en plein désarroi hésitent entre progressisme béat et déclinisme chagrin. En fait, comme avant-guerre, elles ne se sont pas préparées.
La violence monte. Ce n’est pas la fin du monde. Mais sans doute la fin d’un monde. Il ne s’agit pas ici de vendre l’apocalypse. Ni de dire bêtement qu’hier valait mieux qu’aujourd’hui : sur le long terme les chances du progrès l’emportent toujours sur celles du déclin. Mais il y a sur la route des moments où l’addition des risques atteint un paroxysme. Nous vivons un de ces tournants.
Après les élections, que pensez-vous de la situation en Europe et plus généralement de la montée des populismes dans le monde ?
Partout dans le monde (pas seulement en Europe) on assiste à une inquiétante érosion des valeurs civiques. L’abstention progresse partout alors que la pratique démocratique est d’abord une gouvernance reposant sur le consentement actif des gouvernés. Aujourd’hui un tiers des Européens considèrent que voter « ne sert pas à grand-chose ». Et les trois quarts pensent de toute façon que « la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus ». Les sondages récents sont sans appel, car le discrédit est général : 60 % des citoyens européens ne font pas confiance à leur Parlement. Et c’est au sein des classes populaires que l’opinion sur l’inutilité du vote est la plus répandue. Pour les plus jeunes, entrer en politique aujourd’hui c’est joindre l’inutile au désagréable. D’ailleurs, plus de 40 % d’entre eux en France considèrent que la démocratie n’est pas le seul système politique viable.
De manière évidente, tous les piliers de la démocratie classique sont désormais entrés en crise : le pouvoir politique organisé autour d’une représentation parlementaire ou présidentielle est partout contesté. Cette déstabilisation débouche au mieux sur une exigence de « démocratie participative » et au pire sur la recherche de l’homme fort. Deux tentations dangereuses.
Pourquoi dangereuses ?
Si l’on entend par démocratie participative une mobilisation plus active des citoyens au débat, c’est sympathique et… banal : comment une vraie démocratie ne serait-elle pas participative ? Mais la notion est en plus dangereuse comme on l’a vu en France et en Grande-Bretagne à l’occasion des derniers référendums. Ces appels au peuple sont des faux amis de la démocratie. De plus, dans un système capitaliste mal régulé, il est risqué de demander aux dindes ce qu’elles pensent du dîner de Noël.
Raymond Aron nous mettait en garde avec sagesse lorsqu’il écrivait : « l’homme est un être raisonnable, mais les hommes c’est moins sûr. » Arrêtons de parler des vertus de la démocratie directe. Le peuple est souverain, mais la foule est une bête. Il y a des nuits debout où l’on regrette de ne pas rester couché. Les cuistres qui nous battent les oreilles avec Rome et Athènes oublient de dire que ces démocraties n’en étaient pas : seuls les « citoyens » avaient accès au forum, pas la masse de la plèbe qui faisait pourtant l’essentiel du travail. Diogène n’avait pas le droit de participer au gouvernement de la Cité. Je doute que l’on souhaite revenir à ce mode d’organisation sociale.
En sens inverse, oui un pouvoir fort est parfois source d’efficacité. Mais l’histoire a tranché. Le pouvoir d’un seul c’est une maladie qui se croit un remède. Cette dérive a conduit au pire.
En fait, nous avons été, nous sommes, d’une coupable paresse. La démocratie n’existe pas si les démocrates n’en font pas tous les jours la preuve. Nous avons cru que la démocratie était un acquis immanent alors qu’elle est un combat permanent.
Gardez-vous néanmoins l’espoir d’une révolution enfin positive ? Ou basculer vers le pire est-il une fatalité ?
Je suis hanté par cette question : comment éviter aux générations qui viennent de répéter les erreurs de la nôtre ? Nous avons cru à la République, à l’État, à l’Europe, aux Droits de l’homme, à la laïcité, à la démocratie, au progrès de la technologie… qu’avons-nous fait de tout cela ? J’ai longtemps brocardé le principe de précaution comme le symptôme d’une ridicule aversion au risque. Aujourd’hui, je fais volontiers amende honorable. La vitesse enivre. L’excès de vitesse tue. Alors respectons une pause, prenons un peu de recul et mettons en examen les chauffards du toujours plus. Avant de faire son devoir, il faut être sûr de bien le connaître.
Cette incertitude est-elle nouvelle ? Non, évidemment. Les hommes ont toujours été menacés par les forces du mal et leur destin fut toujours d’avancer en aveugle dans le bruit et la fureur. Mais deux phénomènes se conjuguent désormais : une accélération des évènements et une accumulation des risques. Faut-il le taire pour ne pas diffuser l’inquiétude ? Non, René Girard a écrit : « Vouloir rassurer c’est contribuer au tragique. » Il avait raison : penser le pire ce n’est pas céder à la résignation. C’est même la meilleure façon de l’éviter.
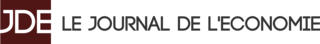








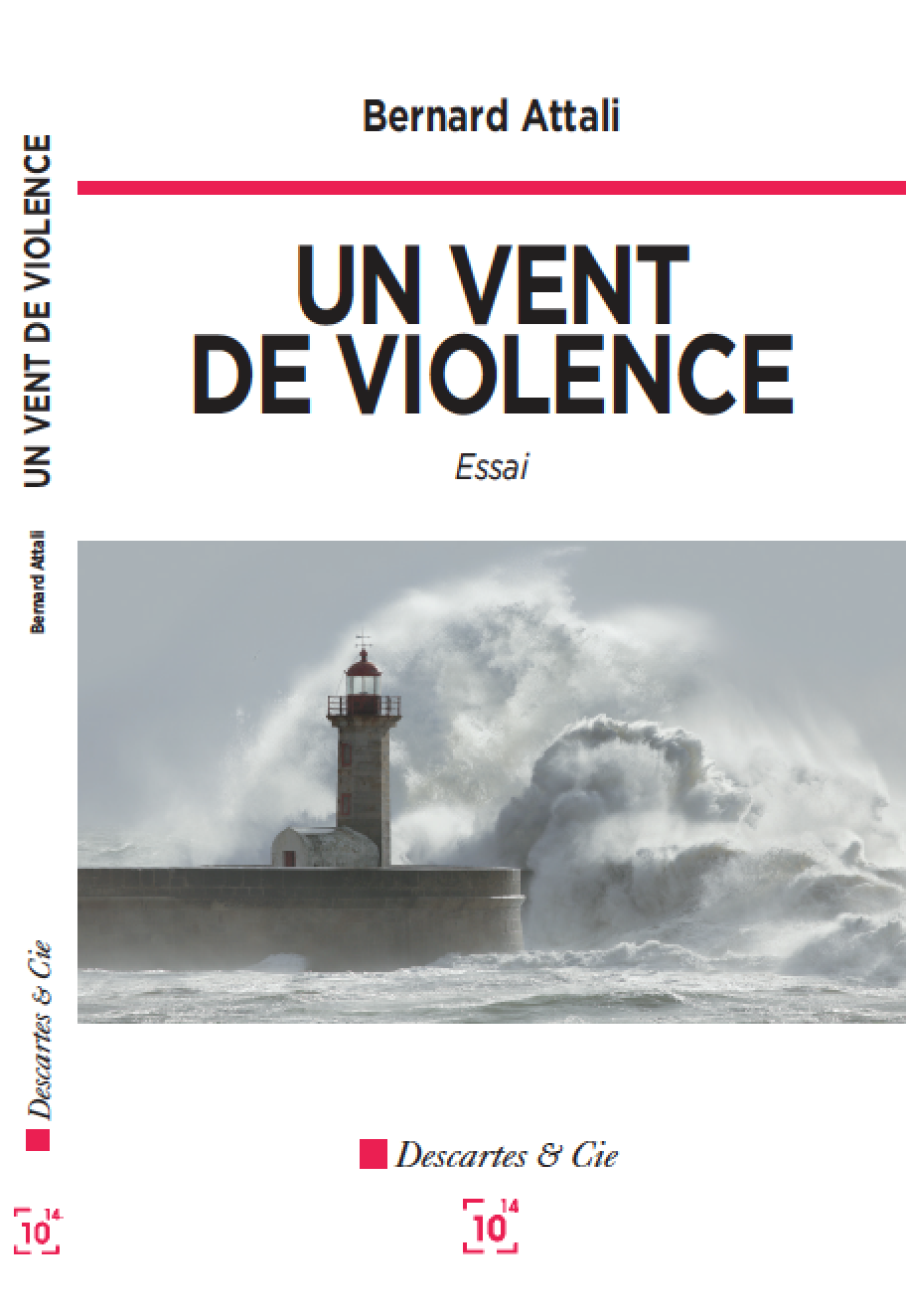
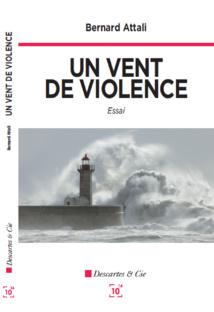





















 Inscription Newsletter
Inscription Newsletter